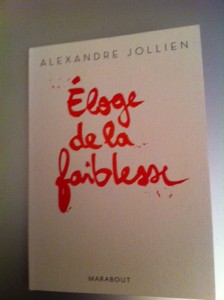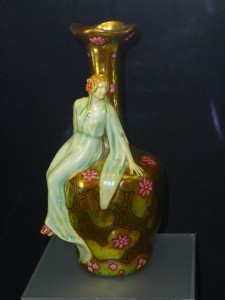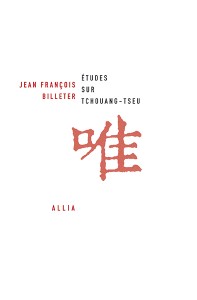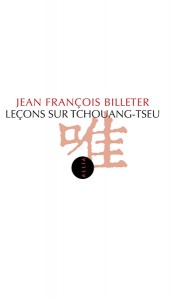Marguerite Duras
Une centenaire et des hypocrites
Marguerite Duras aurait eu 100 ans hier. Les journaux en ont parlé, c’est un auteur reconnu, elle est dans la Pléiade, c’est dire ! Je ne peux pas m’empêcher de ressentir un vague dégoût en lisant ces hommages. De son vivant, elle n’était pas la favorite de ces messieurs critiques littéraires. Son style minimaliste, à la limite de la faute de français, ne leur plaisait pas vraiment. On s’est moqué d’elle, on l’a pastichée, peu d’intellectuels l’appréciaient… Et alors tout d’un coup, elle entre dans le patrimoine sacré des Lettres Françaises ? Elle dont on a raillé la vie tumultueuse, parlant de son alcoolisme, de sa liaison étrange avec un homme plus jeune (dans ce sens, c’est toujours inacceptable et choquant, le jeune homme passant pour un gigolo, un profiteur douteux, alors que les hommes se glorifient de leur liaison avec une femme de vingt ou trente ans leur cadette). Moi je n’ai pas attendu ce moment pour aimer ses livres et l’admirer.
Petite biographie
Elle est née en Indochine, ça tout le monde le sait. Elle y a passé une enfance et une adolescence tristes et misérables, avec son père professeur de mathématiques et sa mère institutrice dans une école d’une région éloignée de Saïgon. Un frère opiomane, une mère qui lui préférait le fils aîné et qui a acheté des terres inondables par la mer, incultivables, dont elle n’a jamais pu récupérer l’investissement. Marguerite arrive à Paris, se lie à la Résistance, son mari est déporté et sera rapatrié par des amis alors qu’on l’avait déjà mis avec les mourants irrécupérables du camp… Puis les films après l’écriture, une autre forme d’avant-gardisme pas toujours bien compris. Enfin, une grande solitude, l’alcool, et Yann Andréa, le compagnon des dernières années…
Un style bien à elle
Pastichée, imitée, mais jamais égalée dans ce style minimal qui décortique les sentiments au scalpel et montre en peu de mots la détresse d’une femme, elle a écrit au moment où Nathalie Sarraute et Alain Robbe-Grillet créaient le Nouveau Roman, mais on ne peut pas dire qu’elle s’est jointe au mouvement. Ses romans décalés parlent de solitude, d’incompréhension, d’une certaine forme de folie calmement assumée dans les lieux les plus improbables, réels ou fictifs. On se croise, on s’évite, on s’étreint pour mieux s’oublier ensuite, la vie passe, indifférente, cruelle, dans un immobilisme trompeur. Ses héroïnes attendent l’amour, le guettent, le reçoivent et le perdent. Il existe mais il est impossible. Du coup, ses personnages masculins sont à l’image de cet amour évanescent : fantomatiques, ils traversent l’histoire de loin, ne s’y engagent pas, ou en sont absents, remémorés. Cela confère à chaque récit un aspect onirique, flottant presque, où le souvenir tourne à l’obsession et les lieux se chargent d’un poids de nostalgie.
Mes préférés
Je conseillerais de commencer par les romans du début pour aborder l’oeuvre de Marguerite Duras dans sa chronologie : Le Ravissement de Lol V Stein ; Dix heures et demie du soir en été ; Un barrage contre le pacifique ; le Marin de Gibraltar ; Détruire, dit-elle ; L’amant ; L’homme atlantique ; les yeux bleus cheveux noirs ; La Maladie de la Mort ; La Douleur…
Extrait
« La chaise longue était à sa place, la table aussi, les revues. Tatiana Karl était peut-être dans la maison. C’était un samedi vers quatre heures. Il faisait beau.
Je crois ceci :
Lol, une fois de plus, fait le tour de la villa, non plus dans l’espoir de tomber sur Tatiana mais pour essayer de calmer un peu cette impatience qui la soulève, la ferait courir : il ne faut rien en montrer à ces gens qui ne savent pas encore que leur tranquillité va être troublée à jamais. Tatiana Karl lui est devenue en peu de jours si chère que si sa tentative allait échouer, si elle allait ne pas la revoir, la ville deviendrait irrespirable, mortelle. Il fallait réussir. Ces jours-ci vont être pour ces gens, plus précisément qu’un avenir plus lointain, ceux qu’elle en fera, elle, Lol V. Stein. Elle fabriquera les circonstances nécessaires, puis elle ouvrira les portes qu’il faudra : ils passeront. »
Le Ravissement de Lol V. Stein, 1964